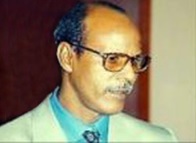
Esquisse d’une stratégie de changement d’orbite
Changer d’orbite signifie changer de trajectoire, rompre doucement mais résolument avec notre mode de gestion de l’Etat, de comportement, de cadre de vie, de perception des obligations et du devoir. C’est une question, non pas de moyens, mais de volonté et de capacité de se mesurer à l’obstacle, comme dit notre célèbre poète Al Moutenabbi.
La stratégie de changement d’orbite gagnerait à s’articuler autour de trois principaux axes que notre gouvernement doit suivre en plus de sa réponse aux préoccupations quotidiennes des citoyens. Ces axes pourraient être affinés au terme d’un débat national serein et responsable dont on ne doit pas avoir peur. Le premier doit viser à introduire des éléments de réforme de l’Etat, le deuxième s’attèlera à réaliser les principaux programmes structurants dont le pays a besoin et le troisième à assagir et pacifier le paysage politique national.
1. La réorganisation de l’Etat
Réorganiser l’Etat peut paraitre difficile pour une élite administrative et politique qui n’a jamais connu que les formes d’organisation traduisant l’héritage jacobin de l’ancienne puissance coloniale. C’est pourtant envisageable et, en tout état de cause, indispensable. Notre appareil d’Etat est encore léger et nos besoins à prendre en compte en termes d’organisation sont simples à cerner. Nous disposons de ressources humaines et d’un capital empirique qui pourraient conduire une telle réorganisation sur la voie d’une réforme offrant l’occasion de renouveler le contrat social liant les Mauritaniens. Pour le moment notre ambition ne devrait pas dépasser trois mesures essentielles :
* Le diagnostic organisationnel de l’Etat
Il est permis de penser que de 1960 à 2008, le système de gestion de l’Etat a été sensiblement le même, avec des nuances insignifiantes en termes de rapport avec les citoyens, de conduite des affaires publiques et de respect des biens communs. Les changements à la tête de l’Etat n’ont jamais inspiré le besoin d’un diagnostic de ce dernier, alors qu’actuellement, cette mesure semble indispensable. On aurait dû procéder à une telle tâche depuis l’avènement de la présente équipe dirigeante pour rendre compte au citoyen de la situation effective de son pays afin qu’il mesure le poids des défis auxquels il est confronté, d’une part et marquer le point de départ qui permettra d’évaluer le bilan de ladite équipe à sa ligne d’arrivée, d’autre part. Cette mission pourrait être confiée à une équipe formée de parlementaires parmi les plus compétents et des experts nationaux et internationaux.
L’harmonisation du cadre juridique régissant l’action du gouvernement
Comme souligné plus haut, les lois et les règlements régissant les différents secteurs, en particulier en matière de gestion des ressources naturelles de tous genres se chevauchent et sont, de ce fait, générateurs de confusion et de conflits de compétences entre les différents départements ministériels chargés de l’action rurale. Pour démêler cet imbroglio et libérer le gouvernement de ces entraves, il serait utile de créer une commission de juristes pour harmoniser lesdits textes et en proposer d’autres plus cohérents.
* La réforme du système de décentralisation
La suppression des premières communes en 1969 était le résultat de leur prétendu échec, alors qu’elles avaient été mises en place progressivement et selon des statuts différents, depuis 1956. L’expérience actuelle entamée depuis 1986, fut précipitée et pèche par des défauts structurels, à savoir une uniformité des missions, du statut, du mode électoral et des ressources. Le découpage communal est sans fondement humain, social ou économique. Le système électoral est identique à celui des pays les plus avancés. Pour cela, entre autres causes, ces communes n’ont pu rendre aucun service aux citoyens et, paradoxalement, au lieu de les renforcer et les réformer, l’Etat a créé une seconde catégorie de collectivités territoriales, en l’occurrence les Régions qui seront vraisemblablement plus débiles et moins utiles que les Communes.
Il faudrait donc, en s’inscrivant dans une perspective de réforme de l’ensemble de l’Administration Territoriale, repenser tout le système de décentralisation en chargeant, de cette réflexion, des professionnels spécialistes des collectivités locales. Le nouveau ministre délégué à la Décentralisation et au Développement local s’est déjà attelé à cette tâche, non sans obstacle.
2. Les programmes nationaux structurants
Par programmes structurants, on entendra des ensembles cohérents d’actions concourant à la réalisation d’un objectif global pour la solution interactive et durable d’un bouquet de problèmes à connotations multiples. Dans notre cas, nous avons besoin d’entreprendre, selon une approche totalement nouvelle, les cinq programmes nationaux suivants :
* Un programme national de réhabilitation de la Fonction Publique
Ce programme est primordial et d’autant plus urgent qu’il doit aider à réaliser tous les autres, car il permettra de reconstruire les fondements de l’Etat à travers le renforcement des corps de fonctionnaires qui en sont la colonne vertébrale. Un Etat sans fonction publique n’en est pas un et une fonction publique sans corps bien formés, bien motivés et bien utilisés est comme une Armée dépourvue de corps d’hommes de troupes, de sous-officiers et d’officiers.
Il convient de désigner une commission d’experts nationaux est la doter d’une feuille de route claire ayant pour but de procéder à un diagnostic de la Fonction Publique et de proposer un train de mesures de nature à la réhabiliter. Cette commission veillera à dépister les titulaires de faux diplômes et à les remplacer par des cadres compétents
* Un programme national de sécurité alimentaire
Ce programme a pour but principal de mettre en valeur nos ressources en eau, en terre et en énergie humaine, car il est paradoxal que nous ayons un énorme potentiel agricole et que nous continuions, depuis 1968 à tendre la main à la communauté internationale comme si nous étions des réfugiés dans notre pays. Le paroxysme du paradoxe est d’autant plus traumatisant que nos citoyens, même sur la berge du fleuve, consomment les légumes et les fruits produits par d’autres hommes et d’autres femmes dans d’autres pays. Il convient de convoquer les états généraux du secteur rural, les promoteurs, les organisations de la société civile pour débattre de la stratégie à suivre afin d’aboutir à l’indépendance alimentaire. Le document-projet d’une telle stratégie devra être élaboré par des spécialistes de tous genres et soumis à un tel débat national
* Un programme national de maitrise des eaux de surface
Notre pays court rapidement au-devant d’une raréfaction économiquement, socialement et géopolitiquement bouleversante de ses ressources en eau. Sa stratégie a toujours été de compter sur les ressources hydriques faciles à exploiter. Nos principales eaux de ruissellement se déversent cependant dans le fleuve, puis dans l’océan à travers le Karakoro, le Garfa, le Niordé, le Gorgol Blanc et le Gorgol Noir. Celles des oueds non connectés au réseau hydrographique fluvial sont inexploitées et vouées à l’évapotranspiration.
Il faut définir une stratégie visant à maitriser 30% seulement de nos eaux de ruissellement par des aménagements durables pour réduire les menaces qui pèsent sur l’existence de notre pays. Ce faisant, nous pourrons (i) multiplier les superficies à cultiver derrière-barrage, en offrant aux adwabas des opportunités de survie pour qu’ils se fixent sur leur terroir au lieu d’encombrer les villes en y renforçant – à juste raison- le mouvement social revendicatif, (ii) créer autour des lacs collinaires à réaliser des pôles de développement où les communautés rurales pourront viabiliser leur cohésion et leurs ressors de solidarité dans un nouvel environnement physique, économique et culturel, (iii) surmonter les problèmes engendrés par la rareté des eaux en créant des possibilités durables de réalimentation des nappes phréatiques, (iv) accompagner le mouvement de sédentarisation en attirant les populations vers des zones viables au lieu de les forcer à se regrouper.
* Un programme national de rénovation urbaine
L’état de nos centres urbains montre que nous sous sommes « fossilisés » en implantant sur le sol la configuration spatiale de nos campements nomades d’antan. Nos centres urbains sont une source de frustration pour nous. Nos communautés rurales s’installent partout sans s’assurer de la viabilité des zones où elles implantent leurs agglomérations et leurs infrastructures, ce qui est source d’un énorme gaspillage des ressources financières et naturelles. Il est donc urgent, avant que nos citoyens ne perdent plus de moyens, d’entreprendre un programme pluriannuel de rénovation urbaine et d’encadrement de la sédentarisation. Il serait opportun de désigner une commission d’experts composée d’urbanistes, de géographes, de sociologues, de juristes et d’économistes pour définir une stratégie à long terme de rénovation urbaine et de maitrise de la sédentarisation, assortie d’un plan de financement. La création du Projet appelé MOUDOUN est une idée géniale, mais il faut doter ce projet de ressources financières plus importances et l’envisager sur une durée autrement plus longue.
* Un programme national de promotion de la culture citoyenne.
La promotion de la culture citoyenne n’est pas une vaine expression poétique du verbiage démagogique d’une partie de l‘élite politique. C’est un besoin réel pour nous, car nous subissons la pression conjuguée des anachronismes sociaux qui ralentissent le développement de notre pays et des sollicitations inhérentes au choix démocratique que nous avons opéré. Or, les tares dont on se plaint, sont celles de la société et non de l’Etat, ces deux pôles étant loin de s’accorder sur la nécessité de faire évoluer les mentalités et les comportements. Mais la responsabilité incombe à l’Etat de prendre en charge l’éducation citoyenne, car l’élite ne s’occupe que de la politique.
Il faudrait désigner une commission nationale qui devra, sans aucune complaisance, identifier les poches de vulnérabilité sociale et d’inégalités génératrices de sentiment d’exclusion et définir une stratégie de promotion de la culture citoyenne en identifiant les acteurs à y impliquer et leurs rôles respectifs. Il est regrettable de constater que nos médias tant publics que privés ne contribuent en rien à cette noble mission d’éducation des populations.
°°°°°°°°°°°
Si nous réalisons ces 5 programmes transversaux, traduisant une volonté d’hommes faisant du mépris de fortune leur hymne spécifique, nous ferons sortir notre pays d’une inquiétante impasse historique à laquelle l’enthousiasme des citoyens et la bonne volonté des gouvernants ne pourront rien changer à eux seuls. Par contre, si nous suivons les sentiers battus durant plus de 60 ans en changeant simplement les titres des politiques et les hommes qui en assurent la mise en œuvre, nous n’aurons plus qu’à attendre de subir le sort de tous ceux qui nous entourent.
3. La stabilisation du pays par la dépolarisation de la vie politique
Il est certain que la gestion actuelle de la scène politique et des rapports avec l’opposition a eu des effets stabilisateurs qui devraient, toutefois, être consolidés à travers une vision systématique tenant compte du paysage politique. Ce contexte autorise à envisager la dépolarisation de la vie politique, au lieu de continuer à consacrer une bipolarité sur la base du seul critère de la position par rapport aux dirigeants au pays. Il faut impérativement rassembler toutes les forces politiques autour d’un programme aussi élargi et impersonnel que possible autour de la consolidation des fondamentaux du pays sur la base desquels on devra définir les repères généraux de la gestion de l’Etat dans tous les domaines.
lecalame

 Contribution au débat national (suite et fin) /Par Isselmou Ould Abdel Kader
Contribution au débat national (suite et fin) /Par Isselmou Ould Abdel Kader






















